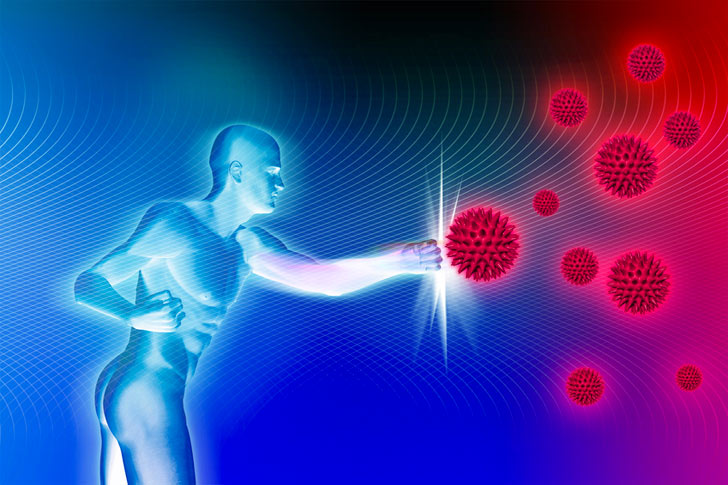Conseils Santé
Les bienfaits de la spiruline dans l’alimentation
Si vous êtes à la recherche de super-aliments, il y a de fortes chances pour que la spiruline en fasse partie. Rappelons que cette microalgue a été déclaré comme étant l’une des meilleures futures sources d’alimentation alternative pour l’avenir lors de la Conférence mondiale de l'alimentation des Nations Unies en 1974.
Lire…Wellsanté soutient Octobre Rose !
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies.
Lire…6 conseils bien-être pour cet été
La printemps est le moment parfait pour prendre soin de soi, et de se retrouver dans l'intimité. Cette période doit faire l'objet de quelques attentions. Ceci afin de vous mettre à l'abri d'un quelconque souci et de vous préparer pour l'été. Voici 6 conseils bien-être pour vous aider à l'été.
Lire…Lutter contre la fatigue et améliorer vos défenses naturelles
Cet hiver améliorez vos défenses naturelles avec notre Curcuma BIO.
L’hiver, notre système biologique travaille davantage pour assurer l’ensemble de nos fonctionnements biologiques.
Parfois à cause d’une alimentation inadaptée notre système immunitaire ne peut recevoir les nutriments pour maintenir son bon fonctionnement. Le résultat de cet état est l’installation des maladies, Rhume, maux de gorge, grippe etc lors du passage à l’hiver.
Le système immunitaire nous protège des agressions extérieures des virus, des bactéries, des champignons, des parasites des tumeurs. C’est un élément indispensable à notre vie et survie. L’immunité n’est pas assurée par un seul organe mais par un ensemble de fonctionnement cohérent. Elle doit assurer sa présence jour et nuit et protège notre corps sans limite du temps.
Le système immunitaire fonctionne grâce à un ensemble de système de réactions biochimiques complexes assuré par plusieurs organes, cellules et substances spécifiques. Les cellules immunitaires se situent majoritairement dans un ensemble d’organes qu’on appelle organes lymphoïdes :
-
La moelle osseuse et le thymus qui produisent les lymphocytes (cellules immunitaires)
-
La rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et les amas de cellules lymphoïdes qui se trouvent sur les muqueuses des voies digestives, respiratoires, génitales et urinaires. C’est dans ces organes périphériques que les lymphocytes agissent en général.
La rapidité d’action des défenses immunitaires est très importantes voire primordiale. Les organes concernés doivent communiquer entre eux de manière efficace. Les organes lymphoïdes ont le système cardiovasculaire comme seule voie de passage qui les relie.
Tous les mécanismes ne sont pas parfaitement connus sur le fonctionnement de l’immunité corporelle. Il existe d’importantes interactions entre le système immunitaire, système nerveux et le système endocrinien. Il y a des similitudes entre les sécrétions des cellules immunitaires et les hormones sécrétées par les glandes endocriniennes, les organes lymphoïdes possédant des récepteurs pour le transfert des messages nerveux et hormonaux.
La réponse immunitaire :
La réponse non spécifique ou «l’immunité innée» dès la naissance et agi selon la nature de l’agression externe.
La réponse spécifique ou «immunité acquise» qui permet la reconnaissance de l’agresseur grâce à la mémoire immunitaire.
La réponse immunitaire non spécifique (primaire)
Les barrières physiques est la première étape. La peau (plus grand organe du corps) est légèrement acide à la surface, légèrement sèche et couverte de bonnes bactéries offre un rempart solide aux bactéries hostiles. Les yeux, la bouche, les oreilles, le nez, les voies urinaires et génitales ont leurs propres réactions immunitaires contre le passage des microbes.
L’inflammation
C’est la première réaction que rencontrent les microbes agresseurs qui franchissent notre corps (peau). L’action par l’inflammation ne connait pas l’agresseur. Le but et de désactiver les agents pathogènes et de réparer les tissus en cas de dommages (lésion). Ces actions passent par des étapes qui suivent :
- L’augmentation de l’afflux sanguin par la vasodilatation (rougeurs) et une plus grande perméabilité capillaire de la zone à traiter pour permettre la réalisation des actions immunitaires.
-
Les phagocytes détruisent les bactéries ou virus pathogènes. Ce sont des cellules qui sont des globules blancs particuliers qui agissent en englobant les microbes pathogènes et les cellules malades et de les détruire. Il en existe plusieurs types de phagocytes : les monocytes, les neutrophiles, les macrophages et les cellules tueuses naturelles (cellules NK).
-
Le système immunitaire complémentaire, comprend une vingtaine de protéines qui détruisent directement les microbes en agissant en cascade. Le système qui agit en complément peut être activé par les microorganismes eux-mêmes ou par la réponse immunitaire spécifique (voir ci-dessous).
Les interférons
Ils font partie des cytokines ayant des propriétés antivirales et anticancéreuses et s’adapte au fonctionnement immunitaire. Il existe un lien étroit entre les interférons et les capacités du système immunitaire. Ce sont des glycoprotéines sécrétées par différents types de cellules, ayant une action régulatrice et stimulatrice du système immunitaire. Ils sont fabriqués par les globules blancs.
Il existe trois types d’interférons :
-
Alpha (2a et 2b) : de production génétique aux propriétés multiples et agit sur le virus d’hépatite B et C par l’inhibition de leur réplication entre autre. Grâce à l’action d’interférences macrophages (un type de globules blancs) augmentent leur activité de phagocytose. Ils ont aussi une action anti-prolifération contre la multiplication anarchique des cellules de certaines tumeurs. Ils sont utilisés aussi dans le traitement du sarcome de Kaposi (maladie cutanée), de sida, certains types de cancers, leucémie à tricholeucocytes (maladie du sang rare masculine), mélanome malin (tumeur maligne), carcinome hépatocellulaire (cancer du foie).
-
Béta : agit sur les scléroses en plaque. Ils diminuent d’environ de 30%, les poussées de sclérose en plaques.
-
Gamma : empêche le développement des tumeurs malignes.
La fièvre est une manière de défendre le corps lors du début d’une infection. Elle accélère les réactions immunitaires. La température élevée du corps lors de la fièvre permet aux cellules d’agir contre les agents pathogènes plus rapidement. Ainsi la reproduction des germes est inhibée et ralentie.
La réponse immunitaire spécifique (secondaire)
Assurée par les lymphocytes B (qui fabriquent des immunoglobulines appelées anticorps) et les lymphocytes T (se trouvent dans le Thymus)qui sont un type de leucocytes (globules blancs).
-
Les lymphocytes B, responsable de l’immunité humorale, représentent pour environ 10 % des lymphocytes dans le sang. Les lymphocytes B sont stimulés lorsque le système immunitaire distingue un microbe pathogène. Ils se multiplient et produisent des anticorps. Les anticorps sont des protéines corporelles qui se fixent sur les protéines étrangères; c’est le début du cycle de la destruction du pathogène. Pour être actifs, leurs anticorps de membrane doivent se lier directement à un antigène (sans passer par le biais d'une cellule présentatrice d'antigène) pour lequel ils sont spécifiques, afin qu'ils se différencient en plasmocytes. Ces lymphocytes possèdent bien plus de vésicules de Golgi, qui permettent de fabriquer des anticorps en masse, afin de neutraliser efficacement les antigènes. Les plasmocytes sont donc des lymphocytes B activés et capables de produire des anticorps dirigés contre l'antigène activateur. Les cellules B sont des lymphocytes qui jouent un grand rôle dans l'immunité humorale (par opposition à l'immunité cellulaire).« B » est l’abréviation de « bourse de Fabricius »1, un organe des oiseaux dans lequel les cellules B arrivent à maturité, et non celle de la moelle osseuse (en anglais : bone marrow) dans laquelle les cellules B sont produites chez tous les autres vertébrés, notamment chez les humains.
-
Les lymphocytes T représentent plus de 80 % des lymphocytes qui circulent dans le sang. On distingue deux types de lymphocytes T : les cellules T cytotoxiques (TCD8 ou T Killer), quand, elles sont activées, détruisent directement les cellules infectées par des virus et les cellules tumorales.
-
Les lymphocytes T auxiliaires (TCD4 ou T helper) sont des intermédiaires de la réponse immunitaire et prolifèrent pour activer en quantité d'autres types de cellules qui agiront de manière plus directe sur la réponse. Les T auxiliaires régulent ou 'aident' à la réalisation d'autres fonctions lymphocytaires. Elles portent à leur surface un marqueur CD4. On sait qu'elles sont la cible de l'infection à VIH ; le SIDA entraîne la chute de leur population.
-
Les lymphocytes T régulateurs (Treg) aident à prévenir l'activation des lymphocytes auto-immunes qui détruisent les cellules de leur propre organisme. Auparavant appelés « T suppresseurs », ils sont très importants pour le maintien de l’homéostase. Le rôle principal est de réprimer l’activité des cellules de l’immunité, soit auto-immune, soit en fin de réaction immunitaire. Ils se distinguent facilement des autres lymphocytes T : ils portent à leur surface les marqueurs CD4 et CD25 à leur état basal, et expriment la molécule FOXP3 dans leur cytosol.
-
Les lymphocytes NKT sont un type de lymphocytes présentant des marqueurs de cellule T (CD3) et des marqueurs de cellules NK. Ils sont donc un lien entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Contrairement aux lymphocytes T conventionnels, dont le TCR reconnaît un peptide présenté dans une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH), les NKT sont capables de reconnaître un glycolipide présenté dans une molécule appelé CD1d, structurellement proche du CMH de classe I. Une fois activés, les NKT sont capables de lyser les cibles et de sécréter des cytokines.
-
Les lymphocytes T γδ représentent une population de cellules T ayant un TCR particulier. La plupart des T possèdent un TCR composé de deux glycoprotéines, les chaînes α et β. Cependant, les cellules γδ possèdent un TCR fait d’une chaîne γ et d’une chaîne δ. Ces lymphocytes sont moins abondants que les αβ (ils représentent 5 % du total des lymphocytes T), mais se retrouvent en plus grande quantité dans la muqueuse intestinale, parmi la population lymphocytaire nommée lymphocytes intra-épithéliaux. Le déterminant antigénique auquel répondent ces lymphocytes est inconnu à l’heure actuelle. Leur TCR ne semble pas restreint à la reconnaissance d’un peptide, mais serait capable de réagir à la présence d’une protéine entière, sans nécessiter la présentation via les molécules du CMH. Il a été montré que les lymphocytes γδ pouvaient être activés via le CD1, molécule apparentée au CMHI mais présentant des lipides glycosylés ou non.
La réponse immunitaire secondaire se ddéveloppe au fil des ans par des expériences des luttes de notre corps selon les microorganismes étrangers spécifiques rencontrés. Grâce à cette mémoire d’action immunitaire déjà effectuée contre les microorganismes pathogènes, la seconde action lors d’une nouvelle rencontre devient beaucoup plus efficace et rapide que la première. Il a été estimé qu’un adulte a en mémoire de 109 à 1011 protéines étrangères d’origine différentes. C’est pourquoi, on explique mieux les mécanismes de défense corporelle permettant de ne plus contracter certaines maladies de nouveau.
La vaccination fait partie de cette action visant à déclencher cette mémoire immunitaire acquise d’une première rencontre avec un microorganisme pathogène.
Recherche et rédaction : Equipe Wellsanté,
Texte créé le : le 15 novembre 2015
Bibliographie
Source : Wellsanté et Wikipedia
Cet hiver, a côté d’une alimentation normale et saine, prenez une cure de notre curcuma pour vous aider à préserver vos défenses naturelles.
Nutrition physiologique
Nous ingérons des aliments au quotidien pour être transformés par notre corps. Ces transformations suivent des principes biochimiques très complexes avant, pendant et après leur ingestion. Tout au long du cycle de la vie d’un corps humain, les aliments servent à subvenir aux différents besoins dits « physiologiques » selon l’âge et le sexe de la personne. Par exemple, les aliments sont prioritairement nécessaires pour la croissance quand on est enfant, pour le maintien des fonctions corporelles quand on devient adulte mais aussi pour produire de l’énergie pour que le corps humain puisse être toujours en mouvement chaque fois que ce sera nécessaire.
Bref, les aliments sont indispensables à la vie. C’est la vie même. Sans les aliments il n’y a pas de vie possible ! C’est pourquoi, les aliments et la nutrition sont des sujets liés et sont si importants que nul ne peut et ne doit l’ignorer.
Lire…